Parade, de Rachel Cusk ou l’audace de la singularité (Gallimard)
Un revival de D.H Lawrence en exil
Qu’un roman comme La dépendance ait connu un retentissant succès est encourageant et confirme la distinction, que je propose dans mes chroniques, entre « gros » et grand public.
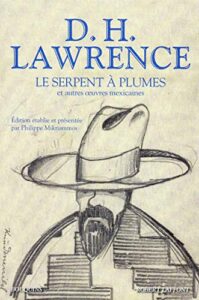 Car enfin cela réfléchit beaucoup, la narratrice se turlupine un maximum dans ce récit plus encore que roman, inspiré explicitement, indique Rachel Cusk, des Mémoires de Marel Dodge Luhan publiés en 1932, qui relatent le séjour, dans sa propriété au Nouveau Mexique, de l’écrivain britannique D.H. Lawrence (1885 – 1930).
Car enfin cela réfléchit beaucoup, la narratrice se turlupine un maximum dans ce récit plus encore que roman, inspiré explicitement, indique Rachel Cusk, des Mémoires de Marel Dodge Luhan publiés en 1932, qui relatent le séjour, dans sa propriété au Nouveau Mexique, de l’écrivain britannique D.H. Lawrence (1885 – 1930).
Celui-ci s’exila souvent pour s’éloigner de l’opprobre que lui valait son exploration des mœurs sexuelles.
Songeons que son fameux roman L’Amant de Lady Chatterley, paru en 1928, resta censuré jusqu’en 1960 ; en même temps, la réputation sulfureuse de ce livre taxé de pornographie pour avoir décrit la libération sexuelle d’une femme, fit la célébrité de l’auteur – comme Lolita en 1955 pour Nabokov qui, à partir de ce roman qui n’est pas son meilleur et n’atteint pas Ada notamment, put publier triomphalement tout ce qu’il voulait.
Ce qui est intéressant, dans le point de départ de La dépendance, c’est que l’exil de Lawrence au Mexique avait déjà été illustré par son roman Le Serpent à plumes, où c’est une femme, veuve irlandaise désabusée par la rigidité des mœurs de son pays, qui comme Lawrence cherche et trouve la régénération dans la civilisation amérindienne.
Rachel Cusk opère un déplacement analogue en transposant l’écrivain en peintre.
La narratrice de La dépendance a créé une résidence d’artistes attenante à la spectaculaire propriété entourée de marais et de bois que son solide époux a aménagée ; et voici que le peintre mondialement connu qu’elle invitait en vain depuis des années accepte enfin de venir… avec une ravissante jeune femme à son bras.
D’admiration en interrogation : la déception
 Pourquoi le peintre s’est-il enfin décidé à venir ? Que vient-il faire ici sans peindre, devant son hôtesse qui ne demande qu’à l’interroger sur son génie, pour s’interroger sur elle-même en fait. M. est une torturée : « Quand on a toujours été critiqué d’aussi loin qu’on se souvienne, il devient plus ou moins impossible (…) de se persuader que l’on existe soi-même. »
Pourquoi le peintre s’est-il enfin décidé à venir ? Que vient-il faire ici sans peindre, devant son hôtesse qui ne demande qu’à l’interroger sur son génie, pour s’interroger sur elle-même en fait. M. est une torturée : « Quand on a toujours été critiqué d’aussi loin qu’on se souvienne, il devient plus ou moins impossible (…) de se persuader que l’on existe soi-même. »
Son second époux, le costaud et laconique Tony, a pourtant su la centrer, au sens, s’explique-t-elle, où il sait « garder la balance de ses plaisirs et de ses devoirs en équilibre parfait. » Il ne lui conseille qu’une chose : d’enfin s’abandonner à la passivité qu’elle s’est toujours refusée, le reste il s’en charge, lui qui au début l’a aimantée par des lettres « extrêmement bien rédigées et poétiques (…), c’était comme s’il battait un tambour, fermement et sans interruption », lui donnant « le sentiment que tant de choses étaient possibles dans la vie. »
Après quoi on se demande, mais pas la narratrice tout à ses spirales introspectives, pourquoi elle va courir après les chiches confidences que lui consentira l’antipathique et apathique artiste.
Le mari, lui, laisse les bavardages aux artistes invités. Une nuit qu’elle lui demande de lui parler, « il a gardé le silence, couché sur le dos dans l’obscurité en regardant fixement le plafond. Puis il a dit : « J’ai l’impression que mon cœur te parle tout le temps. (…) Je crois franchement que Tony considère les discussions et les bavardages comme du poison, c’est l’une des raisons pour lesquelles nos visiteurs l’apprécient tant ; il leur sert en quelque sorte d’antidote (…).
Mais, pour moi, il existe bel et bien une manière de converser qui est saine, quoique rare – une manière de parler au moyen de laquelle on se crée soi-même en s’énonçant soi-même. »
 Une ironie torturée
Une ironie torturée
C’est ce qu’elle espère et quête avec le « grand » artiste… et elle plonge dans le cliché selon lequel un artiste peut nous en apprendre plus qu’un bûcheron, une trapéziste ou un grammairien. Rachel Cusk sait faire parler l’ironie torturée de la narratrice et de cette classe de gens qui béent forcément devant les créâââteurs, n’est-ce pas, comme par exemple les dames de la haute dont savait s’entourer et se faire entretenir le poète Rainer Maria Rilke (sur le poèèète Rilke se pâmant pâmé malin, cela fait du bien de lire le chapitre mordant que lui met Javier Marias dans Vies écrites paru en 2019 dans la collection « Arcades » chez Gallimard).
Interroger les voies de la création artistique
Avec son dernier roman, Parade, Rachel Cusk place à nouveau la figure de l’artiste au cœur de sa narration réflexive. Des artistes, à vrai dire, puisqu’il y en a quatre, d’esthétiques et de parcours différents, mais auxquels la romancière donne à dessein la même initiale, G.
 Tour de force dont on peut dire que Rachel Cusk cherche l’exploit.
Tour de force dont on peut dire que Rachel Cusk cherche l’exploit.
Au point même que son roman peut, secrètement, se lire à l’envers, en commençant par la quatrième destinée d’artiste, se dit-on à la fin. Il s’agit du cinéaste G. qui, à l’approche de la mort de sa mère, se sent contraint de redérouler ses premières années et de sortir de la grisaille où il se protégeait.
Son histoire emboîte-t-elle les trois précédentes ?
C’est une possibilité dans ce roman qui dispose les destins en puzzle ou kaléidoscopes. D’ailleurs, commencer par la fin n’est-il pas induit par l’œuvre du premier G. qui, à la grande consternation de sa femme qu’on entend s’interroger, se met à retourner ses tableaux peints. Comme le peintre allemand Georg Baselitz (né en 1938), qui n’est pas mentionné, et dont la réputation est aussi grande que grotesque, s’il est permis de parler librement : à l’envers, la belle affaire !… Retourner ses toiles, au demeurant torchées dans un style matiériste néo-expressionniste déjà épuisé avant Baselitz : assurément l’effet est bœuf et garanti, mais quoi ?
Rachel Cusk, cela dit, en littéraire philosophe qui s’assume comme telle, tire de là une de ses réflexions constantes sur la violence dans l’élan créatif.
Une discussion haletante
La confrontation est également ce qui surprend puis structure la jeune et brillante G. dont le mari tente de contrôler la vie et l’œuvre.
Mais le coup de maître de Parade est le chapitre central, construit en narration théâtrale entre différentes personnalités concernées par l’art, autour d’une même tablée et de la directrice du musée attenant où l’ouverture de la rétrospective d’une autre célèbre G. a été brutalement interrompue et le public officiel évacué à la suite du suicide d’un visiteur qui s’est jeté du dernier étage dans l’atrium.
Tout y passe, dans cette conversation où le snobisme est intelligent. Les rapports femme/homme ? Rapports vie/mort, voyons !
« Je croyais que la masculinité n’existait plus, fit platement observer Betsy. Je croyais qu’il n’y avait plus que de la violence. Quoi qu’il en soit, dit-elle à Thomas, nombre de gens ont trop peur de se tuer, même s’ils en ont envie. Parce que ce dont ils ont peur, en réalité, c’est d’être en vie. » Le bruit mat du corps chuté dans l’après-midi à deux pas n’empêche pas de caqueter sur l’existence.
La maternité ? Pas si simple…
« Si vous deviez défendre votre enfant, par exemple, vous vous mettriez peut-être en danger sans réfléchir. – Je n’ai pas d’enfant, dit Thomas, mais cette question m’a souvent travaillé. Je sais qu’on y voit là presque un fait admis ; et si ce n’était pas vrai ? (…)
La seule personne qui l’a admis en ma présence, c’est une jeune femme de ma connaissance qui venait d’avoir une petite fille. Elle avait très peur des chiens et, un jour, alors que l’enfant n’était âgée que de quelques semaines, elle l’a emmenée au parc. Alors qu’elle la tenait dans ses bras, un gros chien a couru vers elles en aboyant et, avant de se rendre compte de ce qu’elle faisait, elle a brandi le bébé comme une sorte de bouclier. (…)
Son comportement l’a horrifiée, et ça signifiait, croyait-elle, qu’elle n’était pas faite pour être mère. C’était pourtant une très bonne mère (…).
– Au moins, votre amie avait une excuse, car le chien représentait un véritable danger, dit Julia à Thomas, bien que ce soit précisément ce qui rend son histoire choquante, je suppose. »
Vous avez noté le « je suppose », qui est de ces incises dont Rachel Cusk ponctue régulièrement ses dialogues et descriptions ; il y a, dans son tour d’esprit et donc dans son style, une forme de recul plus subtil qu’ironie subreptice ; cela explique en partie le charme qui se dégage de sa prose, elle approfondit à fleur de peau.
Le bruit d’une comédie humaine
Arrive un autre qui se joint à la table pendant que les serveurs régulièrement s’enquièrent des boissons qui, ma foi, se laissent boire.
« Vous êtes sûrs que je ne vous interromps pas ? dit-il. J’ai voulu visiter l’exposition cet après-midi, continua-t-il à l’intention de la directrice, mais le musée était fermé.
– Il y a eu un accident, dit-elle. Le bâtiment a dû être évacué, et il fallu tout annuler. Certaines personnes présentes ici ce soir sont venues de l’autre bout du monde (…).
– Quel dommage, fit Thomas, parcourant la table. Et je suppose qu’il vous faut maintenant tous repartir à l’autre bout du monde. Cela doit vous paraître étrange, comme si vous étiez venus ici pour créer du silence. J’ai vu une ambulance devant le musée, dit-il à la directrice. J’espère que ce n’était pas trop grave. – Si, plutôt, répondit-elle. Un homme s’est tué à l’intérieur. – Il a d’abord veillé à visiter l’exposition, dit Mauro. Il y a dans cet acte une forme de politesse. »
C’est ainsi que la comédie humaine bruit jusque dans tard dans la nuit, plus ou moins tard dans la vie.
Rachel Cusk n’en fait pas un bal ni mystère, ne craignant pas de penser aussi sérieusement qu’on sourit, quand on y regarde bien.
à lire :
- Les ouvrages de Rachel Cusk ont paru aux éditions de l’Olivier et aux éditions Gallimard, où ils sont traduits de l’anglais par Blandine Longre.
- Parade a paru dans la collection « Du monde entier », 204 p., 20 €, puis en Folio
- Le Serpent à plumes, de D.H. Lawrence, est publié en Livre de poche.
 Une ironie torturée
Une ironie torturée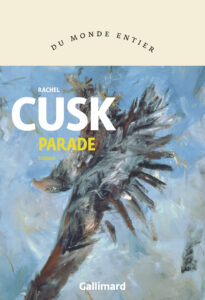 Tour de force dont on peut dire que Rachel Cusk cherche l’exploit.
Tour de force dont on peut dire que Rachel Cusk cherche l’exploit.
