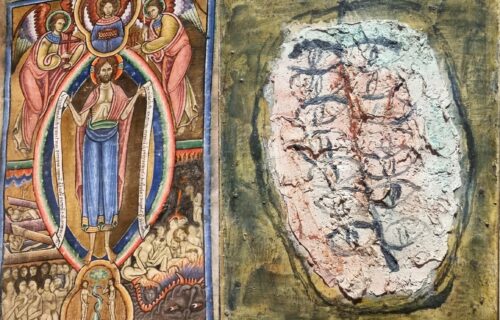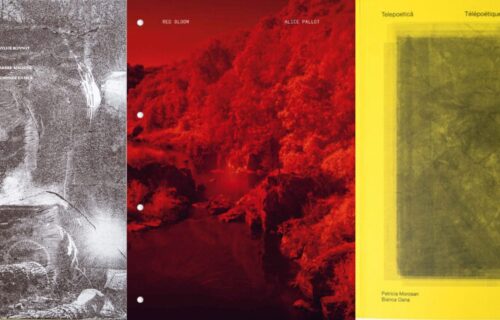Culture
Belinda Cannone dévoile lucidement comment écrivent les écrivains
Quel lecteur n’espère-t-il pas connaitre comment s’y prennent les écrivains « pour se mettre en état d’écrire » ? C’est ce processus – ou pour certains ce « protocole » – qui les engage à se lancer souvent quotidiennement dans une « entreprise d’écriture » toujours incertaine – que Belinda Cannone raconte travers une enquête auprès de 15 auteurs (Thierry Marchaise ed). Stimulé par la chronique d’Anne-Sophie Barreau, Singular’s a voulu en savoir plus sur ce désir mis en œuvre qui conditionne l’écriture. Entretien avec une auteure passionnée et lucide sur la conception de cet essai à la fois personnel et polyphonique.
Dans ce livre construit à partir de votre point de vue, mais aussi à partir d’une enquête auprès d’écrivains français contemporains, vous précisez bien qu’il ne s’agit pas d’un manuel pratique pour savoir « à quoi ça sert d’écrire, ou comment écrire » mais seulement de la volonté de comprendre « comment s’y prennent les écrivains pour se mettre en état d’écrire ». Pourquoi cette restriction ?

Belinda Cannone, auteure de Comment écrivent les écrivains de Belinda Cannone (Éd. T. Marchaisse) photo Lionel Cannone
Il faudrait un livre énorme pour aborder la question du « pourquoi écrire ». Et chaque écrivain ne pourrait y apporter que sa réponse très personnelle… Mon essai ne cherche pas à mettre en lumière les motivations profondes des écrivains et il n’est pas non plus un manuel : on n’y trouve pas de recettes d’écriture.
J’ai juste voulu explorer et mettre en partage la façon dont s’y prennent les écrivains professionnels (je veux dire par là ceux pour qui c’est une activité constante et publique) pour être dans le « bon état » pour créer.
Car, comme le notait le sculpteur Constantin Brancusi : « Les choses ne sont pas difficiles à faire, ce qui est difficile c’est de nous mettre en état de les faire. » Cette question « Comment font-ils, eux, les écrivains professionnels, pour se mettre en état d’écrire ? », tout le monde se la pose.
J’ai donc interrogé quinze auteurs de mes amis ou de mes connaissances, avec bien sûr quelques idées derrière la tête : j’ai une vision assez précise des contraintes, des angoisses et des joies du travail de création, et cette vision m’a permis d’organiser le livre en chapitres thématiques.
Pourtant vous n’hésitez pas à parler de « truc » évoquant les « rituels, routines, méthodes pour parvenir à écrire », il y a donc bien un « stratagème » mis en place par chacun, à commencer par exemple par le fait de ne pas passer une journée sans écrire. En d’autres termes, sans « contrainte » une œuvre peut-elle se construire ou s’échapper de soi ?
Il y a deux sortes de trucs : j’ai observé, en écrivant l’essai, que les écrivains employaient souvent « truc » pour parler de ce qu’ils écrivaient, comme un euphémisme, pour en minimiser la difficulté et l’importance. De la même façon, ils emploient parfois « chantier », comme Marie-Hélène Lafon ou Jean-Christophe Bailly.
C’est une façon de ne pas se faire peur avec… le truc.
Ensuite il y a les astuces, les méthodes, les rituels (autres formes de trucs) qui permettent d’affronter la page et de progresser dans l’écriture du livre.
En fait, tout l’essai parle principalement de cela – des conditions de temps disponible, de lieu, de régularité, de forme physique, des lecteurs rapprochés, etc. – donc je ne vais pas les détailler ici. Mais je crois en effet que, comme l’affirmait Gide, « L’art nait de contraintes, vit de luttes et meurt de liberté ». Aucun auteur, à part peut-être Marie NDiaye, ne vit sans contraintes. D’ailleurs, ils ont tous commencé par me dire qu’ils n’avaient pas de routines, pas de rituels, puis, au fil de l’entretien, on découvre que bien sûr c’est faux. Lorsque Jean-Christophe Bailly me dit d’abord qu’il n’a aucun rituel, finalement il confesse qu’il se donne à lui-même des contraintes de délai, que pourtant personne ne lui impose, et qu’il se sent très coupable s’il les outrepasse…
Je crois qu’écrire représente une telle prise de risque qu’il faut baliser les conditions qui permettent de l’affronter.
Au cœur de votre enquête, dont on pourra retrouver sur le site Les Mots plusieurs interviews qui en ont fourni le matériau, il y a donc la nécessité de conjurer « la peur », mais laquelle : de ne pas trouver le bon état, de la médiocrité ou du ridicule ?
 Tout ça ! Comme je le disais, on s’engage tant, on s’expose tellement en publiant, que l’insuccès est redoutable. J’ai parlé tout à l’heure de prise de risque parce que vous savez, quand un livre est raté (ça demanderait des développements, cette notion de ratage, bien sûr), lorsqu’un livre est raté, souvent l’auteur ne se contente pas de penser : « Cette fois j’ai manqué mon affaire », il se dit : « Je suis définitivement nul » ! C’est souvent une grave remise en question de toute la personne qu’il faut traverser.
Tout ça ! Comme je le disais, on s’engage tant, on s’expose tellement en publiant, que l’insuccès est redoutable. J’ai parlé tout à l’heure de prise de risque parce que vous savez, quand un livre est raté (ça demanderait des développements, cette notion de ratage, bien sûr), lorsqu’un livre est raté, souvent l’auteur ne se contente pas de penser : « Cette fois j’ai manqué mon affaire », il se dit : « Je suis définitivement nul » ! C’est souvent une grave remise en question de toute la personne qu’il faut traverser.
Donc il faut se donner des garde-fous, des rituels propitiatoires, des routines fertiles.
À quoi s’ajoute la peur de ne pas être à la hauteur de son idée de départ, celles d’avoir épuisé sa besace de sujets, sa verve ou son talent, l’inquiétude de ne pas être en phase avec son temps (est-ce que mes idées intéressent le monde dans lequel je vis ?), ou de ne pas être capable d’accéder à une forme d’universalité. Oh, il y a de multiples raisons de s’inquiéter quand on écrit.
Vous avez écrit un livre révélant le « sentiment d’imposture » qui taraude ceux qui ne se sentent pas à leur place. Avez-vous croisé un auteur qui vous en a fait part et qui réussit à le conjurer ou le dompter ?
Aucun ne m’en a parlé. Mais d’une part, c’est toujours un sentiment que l’on préfère cacher (surtout à une « collègue »), et d’autre part je n’ai interrogé que des auteurs connus, ceux qui ont donc relativement réussi dans leur activité et sont un peu plus tranquilles par rapport au sentiment d’imposture. Je précise à cette occasion que j’ai choisi d’interroger ces bienheureux parce que dans un essai où s’entremêlent seize voix, il fallait que le lecteur identifie tout de suite et facilement une personne derrière chaque nom. Citer des auteurs moins connus aurait compliqué la lecture de ce texte partiellement polyphonique.
Mais nous savons tous qu’en général, la notoriété ne signifie pas nécessairement la qualité.
Et puis vous savez, un auteur est quelqu’un qui « invente » sa place.
Il n’a par définition pas à se conformer à une case préétablie : or c’est souvent la nécessité de se conformer à une case toute prête, avec laquelle on ne coïncide pas forcément, qui provoque un sentiment d’imposture. Moi-même qui ai assidument et longtemps éprouvé un sentiment d’imposture à l’égard de bien des choses, je ne l’ai jamais connu pour mes livres, même quand ils connaissaient un échec de réception. Je savais que je devais inventer ma place, mon écriture, que ça faisait partie du programme, quel qu’en soit le résultat…
Donc en essayant, j’étais « dans mon rôle », même si mon effort n’était pas couronné de succès. Je dirais même que c’est ce découplage entre échec et sentiment d’imposture qui m’a aidée à comprendre la nature chimérique de ce sentiment.
Définir cet « état d’écriture », n’est-pas finalement parvenir à déployer cette « écriture du désir », si nécessaire pour réussir son travail, autre dynamique de votre réflexion sur ce qui fait un écrivain ?
Vous avez raison. Dès 2000, j’ai réfléchi à la force du désir comme moteur de l’écriture, en opposition à toutes les idées d’« écriture du désastre » qui circulent dans certains discours sur la littérature.
Il faut la même énergie, la même joie pour se lever chaque matin – même les jours mornes où l’on n’a pas une interview avec Singulars – et pour se mettre à l’écriture.
Et si dans mon essai j’ai souligné les peurs et les inquiétudes que les écrivains cherchent à conjurer par leurs routines et leur mode de vie, j’ai insisté aussi sur la joie que procure l’écriture : l’existence devient tellement plus intense quand on écrit ! D’ailleurs, tous mes auteurs se révèlent être des bourreaux de travail, ils disent aimer la discipline, ils déclarent que bien souvent ils écrivent pendant les vacances, parce qu’ils… « aiment ça ». Ils aiment le travail.
Et n’est-ce pas là une grande définition de l’humain, cet être qui se fixe des objectifs difficiles (écrire en est un), et qui s’acharne joyeusement à atteindre ces Everest ?
Auteur de l'article

Pour suivre Belinda Cannone
- Comment écrivent les écrivains, éditions Thierry Marchaisse, mars 2025:
- Quelques-uns des entretiens de Belinda Cannone seront disponibles sur le « podcast qui donne envie de lire » de L’école Les Mots :
- introduction Comment écrivent les écrivains
- Entretien avec Emmanuel Carrère
- Entretien avec Marie-Hélène Lafon
- Quelques-uns des entretiens de Belinda Cannone seront disponibles sur le « podcast qui donne envie de lire » de L’école Les Mots :
- Comment écrivent les écrivains, éditions Thierry Marchaisse, mars 2025:
Rencontres
- 26 avril, Librairie Le Passage, Alençon
- 23 mai, Epoque, Salon du Livre de Caen, en compagnie de Lilia Hassaine & François-Henri Désérable
- 3 juin, Libraire Les Traversées, Paris 5e, avec Nathalie Azoulai
Bibliographie sélective
- Les vulnérables, 2024
- Le nouveau nom de l’amour, 2020
- S’émerveiller , 2017
- La Tentation de Pénélope, 2010,
- Petit éloge de l’embrassement, Folio, 2024
- L’écriture du désir, Folio essais 2012
- Le sentiment d’imposture, Folio essais, 2009
chez Thierry Marchaisse éditions
- Dictionnaire ‘des mots manquants’ (2016), puis‘des mots en trop’ (2017), et, ‘des mots parfaits’ (2019)
Partager