Jeroen Olyslaegers, La Femme Sauvage (Stock) – Christophe Penalan, Eden, L’affaire Rockwell (Viviane Hamy)
Deux romans de rentrée dans deux genres différents lus par Jean-Philippe Domecq : un aussi fantastique qu’historique, et un polar bien de notre temps. Dans La Femme Sauvage (éditions Stock), le romancier Jeroen Olyslaegers nous plonge, au XVIème siècle, avec une précision saisissante, dans la destinée d’un aubergiste d’Anvers bien placé pour être le réceptacle de tout ce qui s’y passe : conflits politiques et religieux, dernier amour avec une « femme sauvage », le tout sous l’œil du peintre Brueghel. Eden, l’affaire Rockwell (éditions Viviane Hamy), de Christophe Penalan, mène une enquête en ondes concentriques qui révèle une ville américaine autour d’un personnage de victime cerné de zones d’ombre.
La géopolitique d’alors
Amsterdam, août 1577, où le héros, l’aubergiste Beer, s’est installé depuis dix ans qu’il a dû fuir Anvers et ses violences politiques et religieuses, abandonnant son auberge où on avait fini par l’accuser de double ou triple jeu, victime de la bonne ambiance et réputation de son enseigne où il accueillait les uns et les autres en les écoutant et s’interrogeant, de tout son esprit affuté et torturé.
L’auteur belge néerlandophone, Jeroen Olyslaegers a su camper là un personnage à la fois très probable et qui lui permettait de faire revivre les débats, croyances et luttes dont l’Europe du Nord était alors le théâtre particulièrement agité, et décisif pour l’avenir.
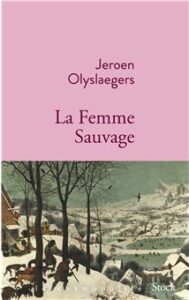 Le très et trop catholique Philippe roi d’Espagne, depuis son lointain, garde la main, lourde financièrement et religieusement, sur les Pays-Bas, veillant à imposer la morale papiste, qui ne lui donne évidemment aucun scrupule pour prélever ses dîmes et pourcentages. Sa férule se crispe face à la montée des luthériens et calvinistes, qui sont animés les uns contre les autres par la solide inimitié des proximités d’esprit (actualisons : la gauche n’a pas son pareil à droite pour taper sur son différent proche bien plus que sur son différent plus différent). Ces groupes se servent du peuple et de la misère pour agiter la ville. Un temps, le prince d’Orange joue le juste milieu pour épuiser les contraires, sans rien résoudre (autre actualisation, si l’on me permet ce délice : l’équation même du centrisme énoncée par le « radical » Henri Queuille (1884 – 1970) :
Le très et trop catholique Philippe roi d’Espagne, depuis son lointain, garde la main, lourde financièrement et religieusement, sur les Pays-Bas, veillant à imposer la morale papiste, qui ne lui donne évidemment aucun scrupule pour prélever ses dîmes et pourcentages. Sa férule se crispe face à la montée des luthériens et calvinistes, qui sont animés les uns contre les autres par la solide inimitié des proximités d’esprit (actualisons : la gauche n’a pas son pareil à droite pour taper sur son différent proche bien plus que sur son différent plus différent). Ces groupes se servent du peuple et de la misère pour agiter la ville. Un temps, le prince d’Orange joue le juste milieu pour épuiser les contraires, sans rien résoudre (autre actualisation, si l’on me permet ce délice : l’équation même du centrisme énoncée par le « radical » Henri Queuille (1884 – 1970) :
« Il n’est aucun problème assez urgent en politique qu’une absence de décision ne puisse résoudre »…). Le tout pendant que les édiles locaux affichent leur impuissance volontaire, ne jurant que par l’ordre mou qui protège les bonnes affaires. »
Déjà la loi du Marché et la spéculation
C’est un thème récurrent des conversations et échanges que restitue ce roman qui, en ce sens aussi, est éclairant sur la constante du profit dans les siècles.
Il y a les spéculateurs, qui toujours accroissent leur fortune en période de pénurie. Durant un hiver particulièrement long et froid, voilà qu’un entrepôt caché par le marchand Pauwel Van Dale s’effondre « sous la trop grande quantité de seigle, dont tout le monde pensait qu’il n’y avait plus un grain. (…) Au début, les gens n’en crurent pas leurs yeux. Ils affluèrent et se jetèrent sur cette manne soudaine. Ils remplirent leurs bonnets de grain, se mirent à se taper sur la gueule, tandis que d’autres sortaient leurs poignards. Mais la majeure partie du seigle fut perdue dans la boue. La rage était à son comble. Bon Dieu, d’où venait tout ce grain ? Comment un homme pouvait-il être infâme au point de cacher ça dans une ville où les enfants, dans les quartiers les plus pauvres, étaient de vrais squelettes ambulants ? Double malchance pour le sieur Pauwel Van Dale… Au moment où le hangar céda dans un dernier soupir, lui-même était justement en train de passer en revue sa marchandise spéculative afin de l’évaluer. Il fut donc lui aussi, avec son gendre, vomi dans la boue, au milieu de ses céréales. »
Tous deux pourtant s’en sortirent, écharpés mais vivants. Puis protégés : les gros bourgeois ne subissent pas les pendaisons et tortures que le roman nous donne à voir, en détails glaçants, quand il s’agit de « faire des exemples » avec des pauvres hères pour tenir le peuple. « Pendant des jours, les rues retentirent de cris, et l’hôtel de ville fit l’objet d’une surveillance resserrée par le bailli et ses troupes. Ce n’est qu’au bout du quatrième jour de troubles que le conseil communal annonça qu’il punirait sévèrement toute spéculation sur les céréales. Aux oreilles du peuple enragé, cette mesure sonna comme un aveu ou l’expression involontaire de sa complicité. C’était l’énième fois que trop de gens se sentaient abandonnés à leur ort, l’énième fois, criaient-ils haut et fort, que ce palais clinquant de la Grand-Place s’était comporté non pas en bon père de famille (…) mais s’était laissé payé à boire par des individus sans scrupule qui plaçaient leur intérêt au-dessus d’une ville dans le besoin. »
Vieille et constante histoire, aujourd’hui qu’on a tendance à oublier que l’appétit du gain est mortifère, criminel si la politique ne le maîtrise pas. Mais Jeroen Olyslaegers est trop fin romancier pour rechercher l’actualisation par analogie.
Les affaires ouvrent au monde, et importent l’Autre et l’Ailleurs
Le héros aubergiste se souvient des conversations entre marchands qui investissent dans la prospection de continents inconnus en envoyant leurs navires chercher passage et nouveaux produits par le brumeux « Grand Nord », qui semble plutôt l’Ouest lorsque n’en revient qu’un seul navire avec, à son bord, une « femme animale » et sa petite fille qui nous évoquerait plutôt une indienne d’Alaska, à moins que ce soit une Inuit, au XVIème siècle on ne pouvait savoir et, là encore, le romancier sait restituer de l’intérieur le mélange d’ignorance et de savoir de l’époque. La « femme » sent le poisson cru, sa nourriture, et reste couverte de sa peau fourrée, tapie dans la chambre d’auberge, au dernier étage, où les marchands s’en débarrassent. Beer accepte contre son gré mais la nourrit attentivement et s’interroge, comme il le fait sur tous sujets. La population ne comprend pas plus que lui, mais les gens paient pour venir voir cette mère et sa fille qu’a immortalisées une gravure. C’est dire ce temps où l’Ailleurs existait encore quelque part en ce monde.
L’étrange union, après les deuils
Beer la prend longtemps pour un animal plus étrange que les animaux. Mais il a une voie personnelle d’entrée à ce mystère non-divin – non-divin pour une fois dans cette époque où le romancier nous restitue très sensiblement que tout s’appréciait en fonction du Divin que l’on tutoyait et croyait présent et témoin partout. Beer reconnaît qu’après tout, lors de la procession du carnaval annuel que son voisin Peter Bruegel l’Ancien a immortalisé en une gravure digne de la Nef des fous, lui-même revêt une lourde peau pour prendre le rôle dévolu à l’Ours, avec son fils très velu, né de sa troisième épouse morte en couches.
C’est son drame, sur lequel s’ouvre sa méditation rétrospective qui constitue ce roman. « Quand un homme a dû rendre à la terre trois femmes l’une après l’autre, et que deux d’entre elles ont en plus quitté ce monde avec un enfant presque à terme dans leur ventre, alors il considère sa semence comme maudite. (…) Chargées comme des bateaux pleins d’avenir, elles ont sombré dans les abysses de la mort avant même d’avoir pu accoster avec leur cargaison. »
Morts d’enfants, cargaisons mort-nées, malédiction : comme on voit, le romancier a l’esprit dans celui d’alors, et c’est une des grandes qualités de cette prenante histoire que de faire percevoir tout depuis la mentalité de nos prédécesseurs en humanité.
La vérité historique prend une dimension littéralement fantastique
Notamment par le contact avec cette humanité, la « Femme sauvage », venue des confins. Avant qu’elle lui redonne sensation tellurique de vivre, le chemin s’ouvre inconsciemment en lui par un avertissement en rêve : « Vers cette époque, je fis un rêve curieux. Je me trouvais dans leur chambre [la mère et sa fille « sauvages »] après une longue journée. Epuisée par les regards de tous ces gens qui l’observaient, la femme animal s’était couchée sur le flanc. A moitié enfouie dans la peau de bête, elle avait le visage tourné vers loi, les yeux clos. De la tête aux pieds, elle se transforma soudain en chaîne de montagnes. Ses cheveux se jetaient dans un ravin entre le cou et les épaules. La ligne de crête culminait dans sa hanche, avant de descendre en serpentant vers les profondeurs, finissant à son pied nu. Au milieu, au niveau de son ventre, la fourrure rassemblée formait une forêt de plis. Elle-même était absorbée dans un rêve, que j’étais capable de voir. »
Et, sans divulguer la suite, disons au lecteur qu’il va y avoir rêve emboîté dans rêve puis emboîtant la réalité…
Décidément, Jeroen Olyslaegers a du coffre et finesse. Un nom à retenir, pour ses romans accomplis et à venir.
https://youtu.be/jj33ozqqI6U
Californie, 2004
Tout autre époque et genre, le polar cette fois. Qui commence par une mise en place à l’efficacité tout hitchcockienne
Un jour banal comme les autres, deux gamines sortent de l’école en fin de journée, marchent toutes deux vers l’arrêt de bus en palabrant, le bus arrive, on monte, mais, au dernier moment, l’une des deux dit à l’autre que non, cette fois elle va rentrer à pied chez ses parents. Pas de problèmes, elle le fait de temps à autre. Sauf que le soir, puis la nuit, les parents s’inquiètent, puis s’enquièrent auprès de la copine, puis s’affolent, et le lendemain l’inspecteur Dwight Myers va devoir étrenner sa promotion dans cette ville de Bakersfield par une enquête terrible.
 La litanie des meurtres
La litanie des meurtres
Commence en effet pour lui, et son sympathique coéquipier Buddy Holcomb, une sinistre tournée. Tous deux vont devoir passer d’enlèvements de gamines à cadavres de meurtriers violeurs, avérés ou supposés – première complication, dirait l’humour noir. Les découvertes macabres s’enchaînent à petit feu, le récit étant entrecoupé de brefs chapitres strictement informatifs sur ce qui menace ou que subissent des adolescentes et pré-adolescentes. Autre ponctuation tout du long : ce que les enquêteurs découvrent progressivement dans tel et tel ordinateur. Certaines images déchirent l’imagination des jeunes policiers.
Si bien que c’est un climat, une ville, qui nous tournent autour.
On se trompe de crime
Les serial crimes et la pédophilie font partie des thèmes narratifs auxquels l’actualité et le genre policier nous ont hélas accoutumés. L’auteur, Chistophe Penalan, domine la thématique, mais ne vous attendez pas à ce qu’il en reste là. Votre lecture à un moment va basculer, s’accélérer en même temps que les enquêteurs vont devoir découvrir quelque chose d’effectivement très imprévisible.
Diaboliquement ingénieux donc, pour couronner ce roman dont l’héroïne se surnomme « Eden »…
Jean-Philippe Domecq
- Jeroen Olyslaegers, La Femme Sauvage, traduit du néerlandais (Belgique) par Françoise Antoine, éditions Stock, collection « La cosmopolite », 2024, 512 p., 23,90 €. On recommande de lire d’autres œuvres de ce romancier.
- Christophe Penalan, Eden, L’affaire Rockwell, éditions Viviane Hamy, collection « Chemins nocturnes », 2024, 384 p., 21,90 €.
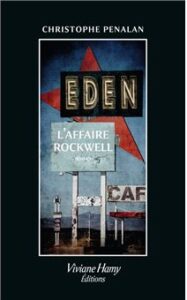 La litanie des meurtres
La litanie des meurtres
