Le carnet de lecture de Ludovic Roubaudi, romancier, Le Diplôme d’Octobre,
Le Diplôme d’Octobre, une satire du dévoiement de la philosophie
Après 17 années de guerre entre quatre puissances, il est décidé la mise en place d’un Empire, une union entre plusieurs nationalités, plusieurs religions. Après une tentative d’assassinat contre l’Empereur, celui-ci décide qu’il faut réécrire un roman national au cordeau pour éviter d’autres guerres. Pour cette effacement de la réalité par un récit, il fait appel à un jeune philosophe, Ephias Sauertieg,
 L’intellectuel est convaincu que « La réalité est pensée. Modifier la pensée et la réalité se transforme » motivé par une principe simple :
L’intellectuel est convaincu que « La réalité est pensée. Modifier la pensée et la réalité se transforme » motivé par une principe simple :
« L’individu ne connait que ce qu’il comprend et ne comprend que ce qu’il désire. Partant de là, nous allons dresser une généalogie des paradoxes et les développer dans chaque sphère de désir qui compose la société. Pour chacune d’entre elles, nous organiserons les incohérences afin de développer un tout acceptable par tous.
Nous ne nous garderons pas de l’antinomie, au contraire, nous en ferons notre axiome. »
Un jour, Ephias Sauertieg est victime d’une tentative d’assassinat. Dès lors, blessé dans sa chair, il n’arrive plus à penser. Il décide de partir à la découverte de l’empire. Va-t-il se rendre compte de la portée de son implication dans l’instauration de cette « pensée unique » qui s’est substitué à l’Histoire, avec pour ceux qui n’y adhérent pas, la perte sociale et la répression qui vont avec ?
Une satire de la pensée unique
L’histoire nous happe très rapidement, l’atmosphère s’insinue entre les lignes, la chape de plomb tombe sur les personnages très bien dessinés. Dans un style de haute tenue, Ludovic Roubaudi nous entraîne dans un univers dystopique aux dérives idéologiques qui pourrait devenir notre réalité.
Au-delà du carnet de lecture, nous avons souhaité creuser les motivations de l’auteur de ce roman satirique qui souhaite nous réveiller sur les risques de la pensée unique.
D’où vient le titre ce cette charge contre un Empire dystopique construit sur l’économie ?
Le titre est tiré de « La loi autrichienne du 20 octobre 1860, édictée par François-Joseph Ier d’Autriche et communément appelé Oktoberdiplom (Le diplôme d’Octobre) visant à poser les bases de la monarchie constitutionnelle après l’échec absolutiste mis en place en 1851 par l’empereur et les défaites de Magenta et de Solferino en Italie du Nord. Fruit d’un compromis entre le centralisme autrichien et le fédéralisme des autres nations, il fera l’objet d’une contestation de plus en plus marqué qui aboutira à son abandon en février 1860.
Pourquoi avoir choisi ce thème ?
Je voulais faire un roman autour de la construction d’une pensée unique. Montrer et expliquer comment une idée peut transformer la réalité du monde dans lequel nous vivons et comment il est difficile de sortir d’une pensée unique.
Je souhaitais montrer le processus de création de cette pensée et expliquer comment le pouvoir utilise sa force et sa persuasion pour l’imposer à la société.
Comment me sont venus les personnages ?
Pour le héros, Ephias Sauertieg, cela a été très facile car je voulais absolument un philosophe comme personnage principal. Il me fallait un personnage qui se retire de son humanité physique pour n’être plus qu’un pur esprit. D’une certaine manière Sauertieg ressemble à ces grands commis de l’état qui vivent exclusivement dans des tableurs Excel. Pour eux, ce qui ne rentre pas dans une feuille de calcul n’existe pas.
Il y a une phrase que j’aime bien sur l’ENA, car elle résume ce que je pense : « Voici une école qui devrait préparer ses élèves à gouverner les hommes, et qui les formes à gérer des choses. »
Sauertieg est l’image de ces hommes-là.
Puis il y a Tzitzillis, le directeur des services (ministre de l’intérieur et directeur des services secrets). Lui il représente le pouvoir dans ce qu’il a de plus tranchant. C’est un homme qui ne croit pas aux idées et seulement aux circonstances. Il veut que la pensée de Sauertieg triomphe car elle sert les intérêts de l’état et il est prêt à tout pour l’imposer.
Alfred Beamte représente le peuple. C’est un homme sans grandeur et sans grande intelligence. Travailler aux côtés de Sauertieg va lui donner du pouvoir et il va accepter de sombrer dans la violence pour préserver ce petit privilège.
Enfin, l’un des derniers personnages, la comtesse Sapienz. Elle représente la bonne société. Ces gens proches du pouvoir qui le servent uniquement pour défendre leurs intérêts. On la croit bonne, généreuse et altruiste alors qu’elle n’est qu’égoïsme. La pensée unique est toujours défendue par des individus comme elle. Elle est la bonne conscience de la pensée unique.
Y a-t-il un lien entre l’actualité et le sujet du roman ?
Je suis effondré par ce que devient l’Europe.
Ce qui devrait être une grande idée n’est qu’une machine économique qui ne se soucie que de croissance, de PIB et de points d’indices. Pour s’imposer, elle nie les nations, les cultures et les identités.
Sauertieg rencontre un jour madame Enjolras qui lui dit :
« Laissez-moi vous donner un conseil : quittez votre tour d’ivoire, plongez-vous dans l’humanité et vous comprendrez que les mots n’ont pas la même signification suivant que vous soyez peuple ou pouvoir.
Là où ceux qui vous payent voient dans les nations des barrières au commerce et un frein à la libre circulation des capitaux, ceux qui y vivent y trouvent une identité et une fierté. Les puissants veulent abolir les frontières pour n’avoir plus qu’une chose à servir : leur intérêt. Lorsque j’étais valache, je ne comprenais ni la langue, ni les coutumes de la Bucovine, du Schweslig ou de la Balteria, mais je pouvais me comparer à eux. J’admirais leurs forces qui marquaient nos faiblesses et me rengorgeais de fierté de nos supériorités. Nous achetions les bottes en écorce des Mencheks parce que nous ne savions pas les faire et leur vendions nos bonnets de laine. Plus ils étaient différents de moi et plus j’étais quelque chose d’unique. Aujourd’hui, je ne sais plus ce que je suis. »
Je pense que la crise identitaire que les différents pays européens traversent vient de là.
Propos recueillis par Patricia de Figueiredo le 22 septembre 2024
Le carnet de lecture de Ludovic Roubadi en 5 livres
 Enid Blyton, Deux enfants dans un sapin
Enid Blyton, Deux enfants dans un sapin
C’est un livre de la bibliothèque rose, celle qui, dans mon enfance, était réservée aux petits. Le texte était écrit en gros et en gras avec des illustrations… on passait à la bibliothèque verte vers 8-10 ans.
C’est le premier livre que j’ai relu… une bonne vingtaine de fois.
C’est l’histoire de deux enfants qui montent dans un sapin à la poursuite du lutin Patatrak qui a enlevé la princesse Rosabelle, et découvrent dans ses cimes un monde extraordinaire.
J’étais fasciné, et le suis toujours, par la possibilité qu’offre un livre de raconter des histoires extraordinaires qui paraissent cohérentes et vraies aux yeux du lecteur. Pour une fois l’imagination n’était plus un rêve, mais une réalité tangible.
C’est là, dans ses lignes en gras et en gros, que mon envie d’écrire des histoires m’est venue.
 Balzac, Splendeurs et misères des courtisanes
Balzac, Splendeurs et misères des courtisanes
Comment raconter des horreurs avec un style et une langue inouïe.
Du haut de mon adolescence, je croyais ces grands classiques rébarbatifs et sans reliefs. Quelle claque. Sans jamais s’appesantir, mais toujours en faisant appel à l’intelligence du lecteur il nous parle de sexe, de mensonge et de trahison. Toute crapulerie humaine défile sous nos yeux et dix, vingt, mille fois on s’arrête sur une phrase, une description un portrait psychologique.
C’est également le premier roman où je n’ai eu envie d’être ni Rubempré ni Rastignac… ni aucun autre personnage. Sans doute étaient-ils trop humains.
 John Steinbeck, Des souris et des hommes
John Steinbeck, Des souris et des hommes
C’est l’écriture qui m’a renversé.
Je lisais les classiques, Dumas, Flaubert, Zola, Musset et toc on me balance une tragédie en trois actes, écrite sans vers et avec une économie de mots hallucinante. Des personnages qui répètent deux, trois fois la même chose… et pourtant avec une musique et un rythme extraordinaire. Écrire moins pour écrire mieux.
Je me souviens en avoir fait la lecture à mes enfants, 10 et 7 ans, le soir dans leur lit. Je revois leurs visages ruisselants de larmes à la fin.
 Tristan Egolf, Le seigneur des porcheries
Tristan Egolf, Le seigneur des porcheries
Dans mon souvenir, le livre ne contient aucune ligne de dialogue et pourtant je connais par cœur la voix de tous les personnages.
Je ne connais l’Amérique que par ses romans et j’aime la multitude de cœur, de corps et d’esprits brisés dont elle est constituée.
Curzio Malparte, Kaputt
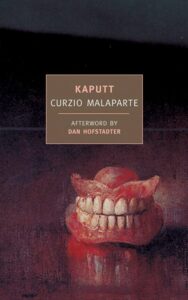 J’ai lu ce livre à 25 ans en me disant que c’était un livre d’histoire, le témoignage d’un temps révolu et à jamais oublié.
J’ai lu ce livre à 25 ans en me disant que c’était un livre d’histoire, le témoignage d’un temps révolu et à jamais oublié.
Je l’ai relu à 55 et je me suis dit que c’était un roman d’anticipation.
C’est un livre essentiel, car il raconte la folie furieuse du cœur des hommes. Une folie naturelle qu’il faut garder en permanence en mémoire pour, seconde après seconde, la contraindre à rester tapie au plus profond de notre être.
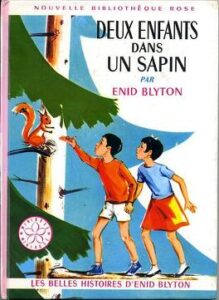 Enid Blyton, Deux enfants dans un sapin
Enid Blyton, Deux enfants dans un sapin Balzac, Splendeurs et misères des courtisanes
Balzac, Splendeurs et misères des courtisanes John Steinbeck, Des souris et des hommes
John Steinbeck, Des souris et des hommes Tristan Egolf, Le seigneur des porcheries
Tristan Egolf, Le seigneur des porcheries
