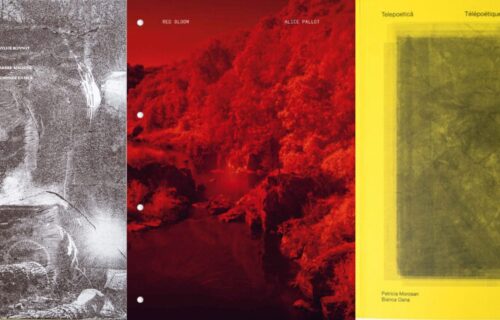Culture
Apocalypse Hier et demain (BNF François Mitterrand), ne pas confondre avec catastrope
Rien d’incongru d’associer la Résurrection de Pâques et l’Agneau pascal à l’Apocalypse. Au contraire! Avant d’être le poncif de notre sidération face à la violence du monde, omniprésente dans notre culture pop, Apokálupsis signifie en grec révélation. En premier lieu, selon l’origine et le sens biblique, celui du Royaume céleste.
La remarquable exposition et catalogue Apocalypse. Hier et demain à la BNF François-Mitterrand jusqu’au 26 juin revient au texte radical de l’Apocalypse de Jean, dernier livre du Nouveau Testament, pour mieux interroger cette fascination des artistes pour la catastrophe et la fin du monde, qui en oublie pour Olivier Olgan celle d’une révélation porteuse d’espérance.
L’Apocalypse demeure ainsi, depuis deux mille ans l’un des plus grands récits symboliques de l’épreuve et de l’espérance ; il est un arrière-plan et un horizon, une invitation à « nous souvenir de l’avenir ».
Jeanne Brun, Commissaire général
Confronter la vision biblique dans l’épaisseur du temps

Beatus de Saint-Sever, Les 4 cavaliers de l’Apocalypse avant 1072 (BnF Mitterand) photo OOlgan
Dès l’entrée, avec les images de Melancholia de Lars von Trier, le visiteur est plongé dans d’exubérantes visions eschatologiques qui du Moyen Âge à la culture pop cinématographique – accompagne le « Livre de la révélation » de l’apôtre Jean qui clôt le Nouveau Testament par l’avènement de la Jérusalem céleste.
S’appuyant sur les extraordinaires illustrations médiévales du texte originel, le début du parcours de la BNF offre un éclairant retour à ce texte cryptique de Jean, à travers ses interprétations et ses symboles aussi marquants que complexes en mettant en lumière le récit originel : le sens positif d’une révélation, celle d’un voile se levant sur le royaume intemporel qui réunira les croyants dans la Jérusalem céleste. Plutôt que d’une fin tragique.
La réussite de cette première partie de parcours est de nous donner de multiples clés de lecture parmi les 140 séries apocalyptiques dont le somptueux manuscrit enluminé du Beatus de Saint-Sever et autres fragments de tapisseries comme la célèbre tenture d’Angers et des projections numériques.
Et pourtant c’est cet imaginaire punitif qui s’est cristallisé à travers des figures presque populaires (la chute de Babylone, les Quatre Cavaliers) continue d’influencer notre époque.
Si le livre aux sept sceaux qui vont briser l’agneau pour faire apparaitre le Fils de l’homme, les sept trompettes sonnant l’arrivée de nouveau fléaux, les sept coupes qu’ils renversent sur la Terre précipitant la bataille d’Armageddon reste des symboles méconnus, les figures des quatre cavaliers de L’Apocalypse, Saint Michel terrassant le dragon, la Vierge debout sur la Lune et couronnée de 12 étoiles, la chute de Babylone et le jugement dernier ont entretenu des siècles durant une régulière fascination sans négliger la figure de prophète à laquelle nombreux d’artistes vont s’identifier, convaincu d’être à leur tour les vigies de catastrophes.
Femme de l’Apocalypse et dragon, Apocalypse glosee, Angleterre (Salisbury), vers 1250 Apocalypse Hier et demain (BnF Mitterand) photo OOlgan
Dans le récit johannique, la Révélation du royaume de Dieu se fait dans l’avant-dernier chapitre, à l’issue d’une série de dérèglements cosmiques et de fléaux qui se déversent sur l’humanité (…) Et comme une grande partie du texte est occupée par la description de ces catastrophes, on a fini par assimiler l’apocalypse à ce qui, dans le livre, la précède.
Jeanne Brun, Commissaire général
L’agneau, figure centrale de la révélation
L’Agneau est pleinement uni à Dieu, siégeant au centre de la vision céleste. Il est le seul digne d’ouvrir le livre scellé, déclenchant ainsi le dévoilement du plan divin pour l’humanité. Il représente Jésus-Christ, désigné comme « l’Agneau immolé », figure du sacrifice, de la rédemption et de la victoire sur le mal. Il est aussi appelé « le lion de la tribu de Juda », associant la force royale à la douceur et à l’innocence du sacrifice, accomplissement du salut et la réconciliation de l’humanité avec Dieu.

Retable du Jugement dernier [panneau central], école flamande, Pays-Bas du sud, fin du xve siecle, (BnF Mitterand) photo OOlgan
Du Temps des catastrophes au magasin d’accessoires d’une culture post-apocalyptique
Il y a là quelque chose de performatif : en parlant d’apocalypse, on craint et on espère à la fois la fin d’un monde et le dévoilement d’un autre.

Tacita Dean, The Book End of TimeApocalypse Hier et demain (BnF Mitterand) photo OOlgan
Sur fond de catastrophes naturelles, et en fond de nos angoisses climatiques et atomiques, plus que jamais, le notion d’apocalypse de familière devient devenue omniprésente. Elle cristallise l’inquiétude, l’angoisse ou parfois. Les artistes convoquées par les commissaires apparaissent comme de véritables reflets et incubateurs de ces peurs.
L’exposition suit ici un fil chronologique, mettant en avant le lien entre l’apocalypse et les moments de tensions eschatologiques qu’a traversé l’humanité, avec les artistes qui s’en sont saisis pour mieux parler de leur temps – d’Albrecht Dürer à William Blake, d’Otto Dix à Kiki Smith en passant par Odilon Redon, Vassily Kandinsky, Natalia Gontcharova aux films catastrophes d’Hollywood. L’apocalypse sert ainsi à dénoncer des événements, exprimer la révolte et l’indignation ou plaider une cause qui se sont laïcisées au fil des siècles dans un monde en déréliction.
Une grille de lecture saisissante du chaos du monde

Zoran Mušič, Nous ne sommes pas les derniers, T. 8, 1972, Apocalypse Hier et demain (BnF Mitterrand) photo OOlgan
Depuis deux siècles, on assiste a un phénomène de reconversion culturelle populaire d’un texte apocalyptique johannique dont la dimension religieuse est délaissée, mais dont, chacune à son tour, les grandes figures symboliques (cataclysmes varies – feu, épidémie, seisme –,cavaliers, Antichrist, bête et grande prostituée) sont mobilisées sur un mode purement imaginaire, sans portée théologique.
On assiste à une laïcisation de cet imaginaire centré désormais sur le seul spectacle de la catastrophe. (…)
De message eschatologique, il est devenu magasin d’accessoires catastrophiques, de Jugement, artifice scénique.
François Angelier, La fortune populaire de l’Apocalypse
Toutes ces visions répondent, transgressent, instrumentalisent nos peurs – sociales, écologiques, atomiques – s’appuyant sur des « révélations » simplifiées souvent mortifères pour rebouter ulilatéralement notre monde abîmé, alors que les réponses sont ailleurs.

Miriam Cahn, Atombombe, 4 mars 1991, Apocalypse Hier et demain (BnF Mitterand) photo OOlgan
Sortir d’une confusion mortifère entre la catastrophe et l’apocalypse
La révélation, dans ce monde d’après la Shoah et d’après la bombe nucléaire, est-elle irrémédiablement celle d’un monde qui s’écroule ? On aurait tort de le penser. La persistance d’une force très présente dans l’ambivalente dualité de l’apocalypse : l’espérance nous implique d’aller au cœur de l’épreuve et de la catastrophe pour voir émerger un monde nouveau.
Avec la lucidité d’un Wittgenstein « Le miracle, esthétiquement parlant, c’est qu’il y ait un monde. Que ce qui est soit. »
« Car aux lieux du péril
Croît aussi ce qui sauve. »
Friedrich Hölderlin
Le salut, peut-être, résiderait alors dans notre regard : dans l’abandon de l’aveuglement dans lequel nous persistons, en appréhendant ce monde comme l’antichambre d’un autre, toujours hors de portée ; dans l’acceptation qu’il est une fin, qu’il comporte précisément tout ce qu’il y a à voir, derrière le voile des peurs et des désirs de le comprendre.
Jeanne Brun, D’en bas : L’apocalypse par les gouffres
Auteur de l'article

Pour aller plus loin sur l’Apocalyspe
jusqu’au 26 juin 2025, Apocalypse. Hier et demain, BNF François-Mitterrand
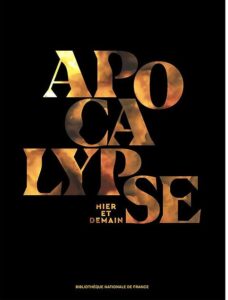 Catalogue, BNF éditions. Somptueusement édité, ce beaux-livre s’impose comme un ouvrage référence, à la fois scientifique et artistique, le creuset idéal pour opérer un retour au texte originel du livre de l’Apocalypse de Jean qui constitue pour l’Occident chrétien le grand récit symbolique de la catastrophe. C’est toute une culture du « concept d’apocalypse » qui est convoquée dans la conviction d’une fin d’un ordre vicié.
Catalogue, BNF éditions. Somptueusement édité, ce beaux-livre s’impose comme un ouvrage référence, à la fois scientifique et artistique, le creuset idéal pour opérer un retour au texte originel du livre de l’Apocalypse de Jean qui constitue pour l’Occident chrétien le grand récit symbolique de la catastrophe. C’est toute une culture du « concept d’apocalypse » qui est convoquée dans la conviction d’une fin d’un ordre vicié.
Les nombreux essais passionnants tentent de le cerner en répondant aux questions : qu’est-ce qu’une apocalypse sans royaume divin, sans révélation glorieuse ? Pourquoi nous accrochons-nous encore à ce mot aujourd’hui ; quelle fin de l’histoire attendons-nous ?
Pour y répondre, une sélection d’extraits littéraires disséminés sont mis en regard de reproductions des œuvres de l’exposition, donnent à entendre les voix d’écrivains connus ou moins connus : Emily Dickinson, Victor Hugo, Mary Shelley à Antonin Artaud, Marguerite Duras, Svetlana Alexievitch ou Audre Lorde.
« La culture populaire apocalyptique vit au rythme de l’histoire et fabrique des fictions qui répondent aux grands événements traumatiques. C’est sans doute la période de la guerre froide qui en témoigne le mieux »
François Angelier, La fortune populaire de l’Apocalypse
A voir
Partager