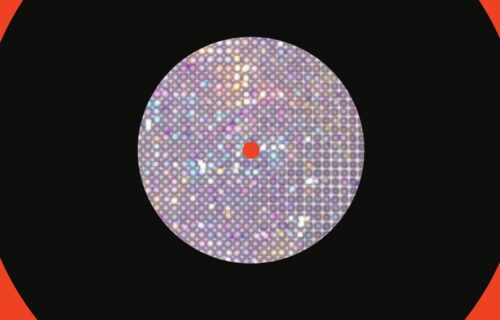Culture
Anne Ibos-Augé, Les femmes et la musique au Moyen Âge (Cerf) pour sortir des clichés
Tenter une étude sur les femmes et la musique au Moyen Age, c’est assumer le risque de la double peine : une affaire essentiellement masculine, et une absence de partitions qui limite toute perspective exhaustive.
Pourtant, l’enquête éclairante quasi topographie sur les lieux de leurs pratiques menée par Anne Ibos-Augé balaye les idées reçues, et révèle qu’à travers des figures singulières, les femmes ont bien été actrices de la musique médiévale. Dépassant les lacunes et les représentations sommaires, la musicologue médiéviste fait revivre avec clarté, pour Olivier Olgan un patrimoine plein de promesses, qu’elle a développé dans son carnet de musique médiévale, invitation à explorer un continent trop mal connu.
Sortir le Moyen Age de ses fictions et représentations
 Face au succès croissant du médiévalisme diffusé par la pop culture – du gothic aux chimères, de l’Héroïc fantasy aux mangas -, chaque génération de médiévistes doit reformuler un plaidoyer pour sortir le Moyen Age des stéréotypes et des imaginaires anachroniques qui l’étouffent : après Georges Duby, L’An mil en 1967, Régine Pernoud, En finir avec le Moyen Age en 1979, encore tout récemment le regretté Martin Aurell, Dix idées reçues sur le Moyen-Age (Champs) en 2024….
Face au succès croissant du médiévalisme diffusé par la pop culture – du gothic aux chimères, de l’Héroïc fantasy aux mangas -, chaque génération de médiévistes doit reformuler un plaidoyer pour sortir le Moyen Age des stéréotypes et des imaginaires anachroniques qui l’étouffent : après Georges Duby, L’An mil en 1967, Régine Pernoud, En finir avec le Moyen Age en 1979, encore tout récemment le regretté Martin Aurell, Dix idées reçues sur le Moyen-Age (Champs) en 2024….
C’est dire aussi la double gageure et l’ambition tenue d’Anne Ibos-Augé que de brosser la vitalité de la musique médiévale en révélant dans une langue alerte « un vrai versant féminin à la culture musicale masculine qui prévaut si souvent dans l’imaginaire comme dans la réalité de la transmission »
D’autant que les causes de l’invisibilité qui ont longtemps perdurées dans l’art en général et la musique en particulier sont données dès la première ligne de son prélude :
« Le Moyen Âge est presque unanime : créée à partir d’une côte d’Adam, la femme est émanation inférieure, redevable à l’homme de son existence même. »
Cette inéfériorisation de la femme se retouve jusque dans les représentations et les personnages de fiction, dominées par l’ambivalence de la figure d’Eve corruptrice et de Marie salvatrice, de la fémininité ensorceleuse ou libératrice, annonçant la mort ou la résurrection. Si les femmes sont bien présentes et actives dans les arts médiévaux, cet imaginaire d’une femme multiple « hélas la dessert bien souvent ».
Une enquête de terrain autant que des parchemins
Malgré les obstacles – liés aux manques de traces des pratiques comme des partitions (aucune par exemple entre 1364 et 1566), la musicologue nous prend par la main – à défaut de l’oreille, l’abscence de playlist associée est compensé ici par quelqes exemples et un carnet de musique médiévale dédié – pour nous révéler les noms, les actions et les œuvres et souvent la position dans la hiérarchie sociale de ces actrices de la musique durant le Moyen-Age.
La musicologue médiéviste rend leur place aux femmes grâce à une érudition éclairante, une qualité d’écriture limpide et une topographie lumineuse des rôles qui rendent son enquête historique si prenante.
Rendre leur voix aux femmes.
Aux uniques figures masculines, le moine, le chantre, le scribe, le troubadour, le commanditaire prennent désormais places leurs équivalences féminines : la moniale, la béguine, la mystique, la copiste, la poétesse compositrice, la ménestrelle, et la mécène. Et avec quel relief !
Pour mieux replacer chacune dans leur contexte, la musicologue-chercheuse n’hésite pas à reconstituer des journées type au château avec les troubadours, ou au couvent rythmées par les prières chantées.
Les bénédictines et les cisterciennes chantaient ainsi presque tout le temps. Même s’il reste toujours difficile de savoir sur quelles musiques !
Hildegarde von Bingen, l’arbre qui cache la forêt
L’importance d’Hildegarde von Bingen est depuis longtemps reconnue. Il faut dire que la mystique – canonisée par Benoît XVI et confirmée Père de l’Eglise en 2012 – coche toutes les cases de l’exception qui confirme la règle. Tout à la fois abbesse, théologienne, visionnaire, et médecin, son rayonnement comme son rôle central dans le monastère ont permis la conservation et la transmission de son corpus d’œuvres monumental comprenant ses 77 compositions de la Symphonie de l’harmonie des révélations célestes.
L’absence de documents
Ce qui ne fut hélas pas le cas de l’essentiel des figures que révèlent la musicologue au fil de l’enquête. Elles ont chacune à sa manière œuvré dans leur contexte à l’émancipation du courant musical féminin : l’encyclopédiste Herrade de Hohenburg, la béguine très prolixe, Hadewijch d ‘Anvers, la scribe Elisabeth de Lünen, la poétesse musicienne d’Oc Azalaïs de Porcairagues, la « ménétrière de bouche » Parisa ou la mécène protectrice de trouvères Marie de Champagne. Sans oublier le rôle déterminant d’Aliénor d’Aquitaine, la mère de cette dernière dans le rayonnement de l’art lyrico-poétique.
Mais rien n’y fait, la représentation de la femme – qui fait l’objet de toute une partie du livre – reste ambivalente voir obscure bien au-delà de l’association au serpent tentateur d’Ève.
Le rôle des femmes troubadours
La comtesse de Die, Carenza, la comtesse Gersenda de Sabran, trobairitz émergent tout de même, d’un monde de cour très masculin, mais non sans mal.
Si peu de chansons composées par des trobairitz nous sont parvenues avec leur musique, les tensons (dialogues) impliquant des poétesses sont plus nombreuses et rendent une part de leur place à ces « domnas » sans lesquelles la courtoisie ne serait rien.
Une enquête qui en appelle d’autres
C’est tout le mérite de cette enquête stimulante, complétée par un glossaire très utile et d’une chronologie courant du Ve – la chute de l’Empire romain – au milieu du XVe siècle – que de réhabiliter ce Moyen Âge au féminin et d’ouvrir le champs à de multiples perspectives afin de combler les manques et balayer une fois pour toutes les idées reçues.
Pour aller plus loin, Anne Ibos-Augé nous a confié son carnet de lecture de musique médiévale pour mettre en perspective les acteurs de la musique tout au long du Moyen Age, hommes et femmes, illustres ou méconnus, véritable invitation à sortir des clichés pop du médiévalisme.
Auteur de l'article

Pour aller plus loin sur le Moyen-Age
A lire :
Dix idées reçues sur le Moyen-Age, Martin Aurell, Champs 2023
Les femmes et la musique au Moyen-Age,Anne Ibos-Augé, Le Cerf 2024
La musique au Moyen-Age en 10 dates
- 387-391 : Saint Augustin écrit le DeMusica.
- 799 : Paulin, évêque d’Aquilée, compose le premier planctus profane : Mecum timavi saxa pour célébrer la mort du duc Eric de Frioul,
- ca 895 : Le traité Musica enchiriadis, attribué à Ogierde Laon propose les premiers exemples notés de polyphonie.
- 1098 : naissance d’Hildegard von Bingen à Bermersheim vor der Höhe.
- ca 1130 : Début de l’activité de Bernart de Ventadour, un des plus célèbres troubadours occitans.
- ca 1180 : Léonin compose les premiers organa de l’école de Notre-Dame
- ca 1228 : Jean Renart écrit Guillaume de Dole, premier roman à insertions musicales. Le Jeu de Robin et Marion d’Adam de la Halle est représenté à Arras.
- ca 1320 : Philippe de Vitry écrit Ars Nova, traité riche de nouveautés en tous genres : mensuration, notation, proportions.
- 1377 : Guillaume de Machaut meurt à Reims.
Partager