Culture
[And so rock ?] Hommage (II) Lou Reed, Berlin (1973)
Auteur : Calisto Dobson
Article publié le 10 octobre 2023
[And so rock ?] Il y a tout juste 50 ans sortait l’album Berlin (RCA Victor) de Lou Reed (1942-2013). Cette œuvre aujourd’hui mythique reçut à l’époque un accueil tant critique que public glacial. Un demi-siècle plus tard, il ne s’agit plus de réévaluer ce qui est largement considéré comme un chef-d’œuvre absolu mais d’en sonder son exceptionnelle intensité émotionnelle. Après le prologue, Calisto Dobson plonge dans l’archétype artistique d’une œuvre au noir : avec les trois premières plages : Berlin (1’35), Lady Day (3’40), Men Of Good Fortune (4’57).
Plage 1 – Berlin, 1’32

Lou Reed Berlin Photo DR
En faisant appel à Bob Ezrin, jeune producteur de 24 ans qui en quatre albums décisifs vient de mettre sur orbite Alice Cooper, il ouvre sans le savoir la boîte de Pandore. Ce dernier, intrigué et séduit par la chanson Berlin, déjà parue sur le premier album de Lou Reed dans une version plutôt enlevée, insiste pour savoir ce qu’il advient du couple décrit dans le morceau. En dévoyant la douce romance de son Perfect Day, Lou Reed et son acolyte de la console vont poser les fondements de l’histoire cruelle et déchirante de Jim et Caroline. Poussé dans ses derniers retranchements par son producteur, le new-yorkais va en quelques jours écrire leur complainte sordide et désespérée.
À Berlin près du mur, tu faisais cinq pieds six pouces de haut,
c’était très chouette, chandelle et Dubonnet sur glace…
Délicat préambule à l’histoire d’amour dévastatrice entre deux amants intoxiqués aux substances narcotiques de tous bords. Un prélude qui ne présage en rien de ce qui va suivre. Nous sommes saisis par un sentiment nostalgique.
Berlin, les chandelles, le Dubonnet nous renvoient à une période qui pourrait faire penser (la musique et l’orchestration nous y aidant), au Willkommen, du film de Bob Fosse, Cabaret sorti un an auparavant.
https://youtu.be/BEgJ5wCNUBs
Une évocation de la joyeuse décadence berlinoise de la fin des années dites folles qui s’achèveront dans le trou noir que nous connaissons. Le chant de Lou Reed est doux, cette voix aux intonations par moments androgynes, distille une intimité pleine de regrets.
Nous étions dans un petit café, tu pouvais entendre les guitares jouer,
c’était très agréable, oh chérie, c’était le paradis.
Un enrobage de douceur qui signera le contraste saisissant entre un propos particulièrement tourmenté et la sensible délicatesse qui l’accompagne. D’autres plus tard se souviendront de cette marque de fabrique déjà bien présente dans les chansons de Lou Reed, en particulier celles du Velvet Underground. Violenter d’une caresse sournoise d’âpres propos aux relents pervers. Typique de certains des comportements de Lou Reed rapportés par de nombreux témoins et journalistes. Sa rancœur face au désastre critique et commercial n’en sera que plus acrimonieuse.
Le piano joué par Bob Ezrin lui-même s’échine et martèle son blues de cabaret langoureux jusqu’au triolet final qui semble œuvrer à la façon d’une porte qui se clôt derrière nous. En présence d’une ombre portée de cinq pieds six pouces de haut sur le mur de l’incommunicabilité, nous voilà mis au défi d’éprouver ce qui sera une traversée sombre, froide et fatale. Manifestation d’une violence malsaine à l’image de sa propre tombe que l’on nous aurait obligé à creuser.
Plage 2, Lady Bay, 3’40
Trois accords de piano enrobés plaqués en semonce résonnent pour introduire Lady Day, hommage à la plus célèbre junkie du jazz et du blues. La divine Billie Holiday détruite autant par ses addictions que sinon plus par l’ordre établi, réactionnaire et raciste. L’évocation de la misère affective de celle qui enchanta le monde du souffle de son blues susurré personnifie avec concision Caroline.

Lou Reed Lady Day Photo DR
En trois vers, Lou Reed, invoque l’infortune de la diva du blues : l’hôtel qu’elle appelle son chez elle, des murs verdâtres et la salle de bains dans le couloir, et en dessine le portrait. Accro au chant, elle ne peut s’empêcher de chanter sa désolation, litanie d’une addiction et Lou Reed de psalmodier :
et j’ai dit non, non, non, oh Lady Day.
Non, non, non, ce n’est pas possible une telle souffrance, si vivante.
Ce non, non, non proféré pour dire un désarroi désenchanté face au destin cruel de la grande dame du jour. Musicalement nous ressentons une sorte de retenue, comme si l’orchestre jouait à peine en retard; ce qui imperceptiblement freine la musique. Lou Reed produit un chant sur le ton d’un enfant à la peine. Les arrangements sont soignés. Instruments à vents, une superposition de claviers, entremêlés de mellotron mettent en avant une trame de music hall berlinois surannée. Des descentes d’accords suivi de remontées tout en scansions qui relève la pénibilité de cette existence dominée par la solitude et la tristesse poisseuse qui en découle.
Quelques années avant l’aventure berlinoise de Bowie et de sa fameuse trilogie, Lou Reed, grand amateur de jazz, se laisse emporter par l’enthousiasme débauché de son Bob Ezrin de producteur. Il s’abandonne et dérive sur une mer mélancolique qui l’emmène sur la grève où s’échoient les noyés de l’existence. Règne toujours au cœur de ses préoccupations l’ambition de fonder une exigence littéraire dans un écrin de musique populaire aux relents de rock’n’roll.
Plus tard, il racontera ses velléités de comédien, qu’il dira avoir transcendées dans des petits morceaux de perversités romanesques de trois minutes. Un petit théâtre à la dramaturgie ornée d’existences saccagées et de tortures mentales. L’influence combinée de ses deux mentors, Delmore Schwartz (homme peu enclin à la complaisance),
son maître en littérature et Andy Warhol son modèle en style et radicalité qui l’ont constamment encouragé à mettre en œuvre ses idées les plus folles font qu’il se sent acculé dans ses derniers retranchements.

Basquiat x Warhol A quatre mains (Fondation Louis Vuitton) Photo OOlgan
Peu à peu, au cours du morceau, sur le modèle de la diva du blues, traversant le couloir de l’hôtel, se superpose la silhouette de Caroline qui s’incarne au travers de l’évocation de la chanteuse martyr.
Dotée de cette grâce de fleur fanée que l’on trouve sur certaines tombes tel un fantôme Ophélien errant dans les décombres d’une existence anéantie. Plus loin, c’est l’ombre du souvenir douloureux de Nico qui surgira.
Plage 3 – Men of good fortune, 4’37
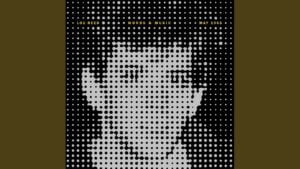
Lou Reed Men of good fortune Photo DR
Le même triolet de piano mêlé à un accord de guitare égrené de do majeur (ces simples accords si affectionnés par Lou Reed), ouvre Men of Good Fortune, une indifférence désillusionnée face aux affaires du monde. En toute quiétude, un ton posé sans maniérisme, un naturel détaché pour exprimer ce qui n’est même pas une lassitude.
Le constat d’une telle évidence, qu’il ne nécessite aucune émotion. Ses fameuses séances d’électrochocs subies à 17 ans et leurs effets délétères ont été un point de non retour. À partir duquel il se serait désinvesti de ce qui fait courir le monde.
Men of good fortune, often cause empires to fall,
(Les hommes riches, souvent causent la chute d’empires).
Résumé en une phrase, la perte de sens, l’inanité même de la cause humaine pour rallier et en conclure l’abjection :
while men of poor beginnings, often can’t do a thing,
alors que les hommes de pauvres extraction, ne peuvent souvent rien faire du tout. Le capitalisme raillé en deux lignes munies d’un léger écho pointé de réverbération sur la voix, sur des accords de guitares scandés en toute retenue :
the rich son waits for his father to die, (le fils de riche attendant que son père meurt),
the poor just drink and cry, (le pauvre ne peut faire que boire et pleurer).
La simplicité de ces vers voue l’indigence occidentale à l’hégémonie du capital, cause de catastrophes et de misère.
Et pour finir par lâcher son désenchantement :
and me I just don’t care at all, (et moi je n’en ai rien à faire du tout.)
Soulignant une impuissance mais surtout un désintéressement qui se projette ailleurs. Pour les renvoyer dos à dos, qu’ils soient riches ou pauvres, le résultat est sensiblement le même.
Men of good fortune, often can’t do a thing, while men of poor beginnings, often can do anything.
(Les hommes de bonne fortune, souvent ne peuvent pas faire grand chose, pendant que les pauvres peuvent faire ce qu’ils veulent.)
La richesse est aussi en soi une prison qui t’empêche, alors que la pauvreté offre une autre liberté d’être et s’il s’agit de relever des tentatives de mérite elles n’en sont finalement pas.
At heart they try to act like man, (au fond ils essaient d’agir en homme),
handle things the best way they can, (gérer les choses du mieux qu’ils peuvent).
They have no rich daddy to fall back on, (ils n’ont pas de père riche sur lequel se rabattre).
Les pauvres essaient et n’y arrivent pas, ils tentent d’y parvenir et en meurent. Pendant que les riches se gorgent de leur légitimité dévoyée.
It takes money to make money they say, look at the Fords but didn’t they start that way ?
(Il faut de l’argent pour faire de l’argent disent ils. Regardez les Fords n’ont-ils pas commencé comme ça ?)
De toute façon, cela ne fait aucune différence pour moi, même si j’espère souvent qu’ils en crèvent, je n’en ai rien à faire. Pendant que les pauvres espèrent avoir ce qu’ils ont, pour l’avoir ils en meurent, toutes ces belles choses que la vie a à offrir, ils veulent de l’argent et vivre, mais moi je n’en ai rien à faire. Dont acte. Puis en boucle, répétant désabusé,
Men of Good Fortune, Men of Poor Beginnings, Men of Good Fortune, Men of Poor Beginnings, Men of Good Fortune, Men of Poor Beginnings…
conscient qu’il s’agit d’une malédiction sans fin.
Le détachement unilatéral exprimé ici est le témoin d’un refus. Celui du moule sociétal, le combat pour une ascension sociale est perdu d’avance, les dés sont pipés.

En savoir plus sur Lou Reed
La chaîne youtube officielle de Lou Reed
- dont l’album Berlin (official audio)
- Berlin (3:23)
- Lady Day (3:40)
- Men Of Good Fortune (4:37)
- Caroline Says (I) (3:57)
- How Do You Think It Feels (3:42)
- Oh, Jim (5:13)
- Caroline Says (II) (4:10)
- The Kids (7:55)
- The Bed (5:51)
- Sad Song (6:55)
« Tu prends tous mes disques, tu en fais une pile, tu les écoutes dans l’ordre chronologique, et tu as mon grand roman américain. »
 Lou Reed, Traverser le feu, intégrale des chansons Seuil, 2008. Trente albums, du Velvet Underground aux derniers textes pas encore enregistrés. Derrière l’icône rock, une œuvre de poésie urbaine qui traverse un demi-siècle. « À un certain point avec de la chance – vous avez un recueil. Pas un Best of mais tout… depuis le tout début jusqu’à aujourd’hui. C’est intéressant en tant qu’auteur de voir ces paroles de chansons – de les lire attentivement et de résister à l’impulsion de les refaire toutes. Des traducteurs demandent des explications de mots, d’expressions qui ne peuvent pas être données. Certaines choses sont inconnues. Certaines questions sont sans réponse. Et parfois l’écriture était simplement le rythme et la sonorité et créait des mots sans autre sens que le feeling. J’ai essayé de rester fidèle à toutes mes chansons. Il n’y en a pas de préférées. » Lou Reed.
Lou Reed, Traverser le feu, intégrale des chansons Seuil, 2008. Trente albums, du Velvet Underground aux derniers textes pas encore enregistrés. Derrière l’icône rock, une œuvre de poésie urbaine qui traverse un demi-siècle. « À un certain point avec de la chance – vous avez un recueil. Pas un Best of mais tout… depuis le tout début jusqu’à aujourd’hui. C’est intéressant en tant qu’auteur de voir ces paroles de chansons – de les lire attentivement et de résister à l’impulsion de les refaire toutes. Des traducteurs demandent des explications de mots, d’expressions qui ne peuvent pas être données. Certaines choses sont inconnues. Certaines questions sont sans réponse. Et parfois l’écriture était simplement le rythme et la sonorité et créait des mots sans autre sens que le feeling. J’ai essayé de rester fidèle à toutes mes chansons. Il n’y en a pas de préférées. » Lou Reed.
Partager



![[And so rock ?] Punk.e.s, de Rachel Arditi et Justine Heynemann (La Scala Paris)](https://singulars.fr/wp-content/uploads/2024/04/punk.e.s-de-rachel-arditi-et-justine-heynemann-la-scala-paris-photo-dr-1-scaled-500x320.jpg)

